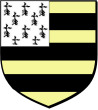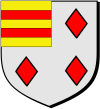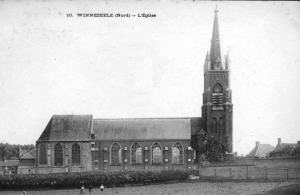|
Winnezeele par le moine Sanderus (1641)
Winnezeele est un bourg
charmant, étendu et approprié à la chasse, avec plaines et reliefs. Il
relève de la propriété du monastère Saint-Augustin de l'ordre des
Prémontrés, près des Morins. Les moines sont les exécuteurs du testament
"Bon. Mem." , du seigneur de l'époque, Jacques, évêque des Morins en l'an
1301, …. de Philippe de Watou (?) avant la mort de ce seigneur Jacques.
Ils firent verser une dîme, assurée par le seigneur Roi duquel il
tenait le fief comme les archives de Thérouanne en attestent. Et ces
prémontrés avaient ici d'autres droits et revenus. Depuis longtemps
l'église de Winnezeele est dédiée à Saint-Martin évêque de Tours. Une
Guilde de Saint-Sébastien a été mise en place par autorisation royale et
elle est dotée de bénéfices et d'exemptions, sur un fonds du seigneur de
Averoult. Une célébration spéciale a lieu le jour de Pentecôte et le jour
de la Saint Sébastien. Non loin de Winnezeele, sous l'autorité du seigneur
de Helfaut, on trouve une chapelle dédiée à Saint Laurent, fondée par la
seigneurie et où se retrouve fréquemment la population en novembre. Parmi
les anciens seigneurs de Winnezeele la famille des Averoult se distingua
par ses bienfaits. Elle compta parmi ses membres, près de Winnezeele, un
membre illustre, Antonius de Averoult, chevalier, seigneur de
Helfaut, vicomte de St-Donas, baron de Mastines, seigneur de Ingehem Pont
Dardennes, etc... Sur l'origine de la famille Averoult, dont les mérites
dans la gestion des affaires furent grands, magnifiques et nombreux, j'ai
pu lire qu'en l'année 1327 Nicolaus Daveroult, chevalier, comparut avec
Adelolpho à S. Aldegunde, lui-même chevalier, devant Jean de Clarkes juge
à Saint-Omer. Eclatants furent en particulier les mariages avec d'autres
familles. Parmi lesquels un mariage ancien et remarquable avec une fille
du Duc d'Angleterre, d'où les insignes des armoiries de Bretagne sur l'écu
de la famille de Averoult. D'autres gens de cette famille sont connus à
Winnezeele comme dans la seigneurie qu'ils possédaient ; de nombreuses
mentions gravées ou écrites depuis 1234 ont été retrouvées. A l'intérieur
de la paroisse de Winnezeele se trouvait le domaine de Cornhuyse qui avait
un maire et des échevins avec tous les degrés de justice. Il était la
propriété de Charles de Cornhuyse qui ne possédait pas seulement cela mais
avait une demeure splendide à Oudezeele. C'était une famille noble et
illustre dont il sera encore question.
Extrait de "Flandria
Illustrata"
Traduction du texte original en latin effectuée par Mr
André SWEERTVAEGHER membre du club CRGFA de Bailleul
retour
Le Blason de Winnezeele
et son évolution
Ce blason représente les
armoiries de la famille d’Averoult, seigneur de Winnezeele. Le blason est
propre à la commune, les branchages sont le symbole de la monarchie et le
blason, du fief de Winnezeele. Il date de 1119, il a été utilisé tout au
long du moyen-âge et ce jusqu’à la révolution. Il fut apposé sur le donjon
du château de Winnezeele.

Le second blason fut celui
utilisé après la révolution. Les symboles de la monarchie (les
branchages), ont été abolis par les révolutionnaires en
1801.
Définition héraldique : D’or à trois fasces de sable, au
canton d’hermines.
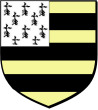
Le blason de 1801 sera
modifié en 1852 afin d’effacer toutes les traces de l’avant révolution et
ainsi redonner de l’ampleur au comté de Winnezeele.
Définition
héraldique : D’argent, à quatre losanges de gueules, celle du chef à
dextre cachée par un franc-quartier d’or à deux fasces de
gueules.
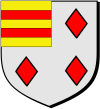
Ce quatrième blason est
celui utilisé de nos jours. Il fut remodelé en 1992 afin de produire un
"pins" à l’effigie de la commune. Il est utilisé sur les documents à
en-tête et les enveloppes de la mairie.

retour
Les Seigneurs de
Winnezeele
1168 - Philippe DE HILL, seigneur
de WINNEZEELE
1298 - Williaume de WINNICZELES
1320 -
Gérin, Pasquier et Jehan de WINNISELLES
1340 - Williaume et
Gérin de WINNISELLES
1370 - 1371 - Jehan de
WINNIZELE
1384 - Jehan de WINNIZELE, chevalier
1474 -
François de WINEZELE, grand bailli de FURNES
Au 15ème siècle, Françoise
de WINNEZEELE, dernière du nom, épouse Messire Antoine d’AVEROULT,
seigneur d’HELFAUT
1502 - Antoine d’ AVEROULT, dit Antoine 1er,
Seigneur de WINNEZEELE, du HILL, Burgrave de St DONAT, Seigneur de
WINNEZEELE Oost-Houck et Middelhouck
1539 - Antoine d’ AVEROULT,
dit Antoine 2, époux de Jeanne du BIEZ - Antoine d’ AVEROULT, dit
Antoine 3, époux de Jeanne de RENTY
1644 - Antoine d’
AVEROULT, dit Antoine 4, Seigneur d’ HELFAUT, Vicomte de St DONAT,
Baron de MASTIGNES, Seigneur de INGEHEM, Pont d’ARDENNES,
WINNEZEELE
Jeanne, Marie d’ AVEROULT, fille et héritière d’Antoine 4 et
de Marie de LENS, épouse Charles-Philippe comte de RUBEMPRE, de VERTAIN et
de VERTIGNEUL, colonel d’infanterie
1680 - Antoine, Ignace, fils
de Charles-Philippe de RUBEMPRE, Comte de RUBEMPRE, d’ AUBIGNY,
Seigneur de WINNEZEELE et du HILL, époux de Jacqueline, Thérèse de
TRAZEIGNIES, chanoinesse de Maubeuge - Philippe, Antoine, Joseph de
RUBEMPRE
1699 - Sabine, claire de RUBEMPRE, chanoinesse de
Maubeuge, tante à Philippe, Antoine, Joseph de RUBEMPRE - Louise,
Brigitte Princesse de RUBEMPRE, épouse en 1704 Philippe de MERODE,
devenu par cette alliance Prince de RUBEMPRE, brigadier et colonel,
conseiller d’état de l’Empereur
1742 - Maximilien, Léopold,
Joseph Prince de RUBEMPRE et d’ EVERBERGHE, comte de VERT, VERTAIN
et de VERTIGNEUL, Seigneur de WINNEZEELE
1770 - Catherine,
Joséphine Princesse de RUBEMPRE, épouse Philippe, Maximilien WERNER,
Comte de MERODE, marquis de WESTERLOO et de TRELON
10 Novembre
1776 - Jacques, Charles, Antoine CARTON, écuyer, Seigneur des
TOURELLES, échevin d’ YPRES devient par achat Seigneur de
WINNEZEELE, du HILL et de la vicomté de ST DONAT
1789 - Dame
Marie, Josèphe, Victoire MERGHELYNCK, veuve de Jacques, Charles CARTON,
Dame de WINNEZEELE.
retour
Les Maires de
Winnezeele
1790 - Jean, Louis
SOCKEEL
10 Novembre 1792 - Augustin MARKANT
15
Messidor an 8 (4 juillet 1800) Maire provisoire Pierre
DESWARTE
20 Thermidor an 8 (8 Août 1800) Charles, Yves
GOUSSEN
Floréal an 13 = Mai 1805 - Maxence
GOUSSEN
13 Août 1807 - Yves SOETEMONDT
4 février 1808
- Jacques SOCKEEL, notaire
18 Mai 1813 - François
GOUSSEN
1832 - 1838 - Jacques SOCKEEL
1838 -
1865 - Louis WYCKAERT
1865 - 1892 - Antoine
VERRIELE
1892 - 1896 - René RENIER
1896 - 1897 -
Pierre VAN INGHELANDT
1897 - 1932 - Gustave
VERRIELE
1932 - 1945 - Pierre REUMAUX
1945 -
1960 - Marcel HEYMAN
1960 - 1965 - Charles
DECROCQ
1965 - 1971 - Michel REUMAUX
1971 - 1980
- André DECROCQ
1980 - 1990 - Daniel
HUYGHE
1990 -
-
Paul DEQUIDT

retour |
Le
Château de Winnezeele
A gauche de l’église, dans
le pré qui s’étale en face de la ferme, s’élevait le château du seigneur,
château que Sanderus a reproduit dans sa "Flandria Illustrata".
C’était une jolie construction Renaissance en briques, formée de
deux corps de bâtiment orientés est-ouest et nord-sud et se coupant à
angle droit. A l’intersection se dressait une tour hexagonale surmontée
d’une coupole à forme bulbeuse qui portait une girouette. Le pignon
principal, à l’ouest, percé de deux larges baies, l’une au
rez-de-chaussée, l’autre à l’étage, aux rampes ornées de redents, était
flanqué de deux tourelles à poivrière qui lui donnaient ampleur et
élégance. Un peu en retrait de l’autre pignon, plus simple et tournée vers
le nord, s’adossait une construction surajoutée beaucoup plus basse et de
faible étendue. Le château était entouré par de larges fossés qui en
défendaient l’accès. On y pénétrait par un large pont de bois au bout
duquel s’ouvrait une porte à fronton angulaire surmontée de créneaux. A
droite de la porte, à l’angle du quadrilatère, s’élevait un élégant
pavillon coiffé d’une poivrière et d’une boule allongée ; enfin de
part et d’autre un mur peu élevé rejoignait les pignons et clôturait la
petite cour intérieure. A côté se trouvaient les communs et dépendances,
les écuries, les loges pour la meute de chasse, les jardins découpés en
parterres et clôturés, le verger avec ses alignements symétriques de
pommiers. Une belle avenue bordée d’arbres aboutissait d’une part au
contour de l’église, de l’autre à l’entrée principale du château qui
s’ouvrait sur la route au sortir du village. Si l’on s’en rapporte à la
tradition, à en juger d’ailleurs par les lignes et les enfoncements du
terrain, les fossés du château devaient communiquer à l’ouest par une
dérivation avec une "motte ou mottelelette" située au delà de la route.
Cette motte, dite "motte féodale" est actuellement un îlot pittoresque,
couvert d’un taillis tout bruissant de la présence d’une multitude
d’oiseaux à l’heure où le soleil se couche. Cette haute demeure
seigneuriale qui fut habitée jadis par les d’AVEROULT, les ELFAUT et les
RUBEMPRE, disparut en 1762. De cette élégante construction en briques
roses, de ces bassins larges et profonds où se balançaient les cygnes, de
ces beaux jardins si bien entretenus, il ne reste plus rien. Les bassins
et fossés comblés, le terrain fut nivelé, ce qui explique l’enfoncement du
pré à un niveau beaucoup plus bas que les terres environnantes. Les
briques ont servi à rebâtir la ferme qui se trouve à la limite du pré,
l’on y voit encore deux poutres sculptées, portant la date de 16.. et le
nom d’ELFAUT. Avec la pierre armoriée qui se conserve à l’église, c’est le
seul vestige de l’ancien château de Winnezeele

retour
Eglise
Saint Martin
L’église, dédiée à Saint
Martin, a été bâtie au 17ème siècle sur des restes anciens (incendie causé
par la foudre en 1646). La tour, ainsi que les deux nefs latérales, sont
du 19ème siècle. A l’intérieur, l’église offre cinq travées. De grosses
colonnes rondes, revêtues de plâtras, séparent les trois nefs.
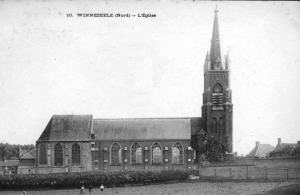
Celui ci se compose d’un
ensemble de lambris qui adopte la forme polygonale du sanctuaire. Les
trois travées de ces lambris sont rythmées par des pilastres à l’aplomb
desquels s’élancent, au dessus de la corniche, de longues volutes qui
supportent un dais. Cette disposition s’inspire du baldaquin. Un tableau
occupe le centre de la composition. Sur le dais est sculptée la colombe du
Saint esprit. Le décor du chœur date du 18ème siècle.
La chaire, dite de
Jansénius, est classée monument historique depuis 1913. C’est l’un
des plus beaux joyaux de l’art religieux du Nord de la France, et elle
constitue un précieux spécimen pour l’histoire de l’art flamand. Datant du
début du 16ème siècle, cette chaire de Vérité, provenant de la cathédrale
d’Ypres, fut adossée à l’un des piliers de la nef centrale en 1844, grâce
à Mr Carton des Tourelles, Marguillier de l’église Saint Martin d’Ypres et
ancien seigneur de Winnezeele. En chêne sculpté et de forme hexagonale,
elle comprend cinq bas reliefs :
- "La prédication de Saint
Jean-Baptiste"
- "Moïse recevant les tables de la loi
sur le mont Sinaï"
- "Le sermon sur la montagne", où était
représenté le Christ
- "Saint Paul parlant aux juifs"
- "La prédication de Saint
Pierre"

Au cours de la nuit du 2
juin 1977, ces superbes panneaux ont été volés, ainsi que la statue de la
vierge qui avait échappé au sinistre de 1646. Les panneaux furent
retrouvés en 1999 chez un recéleur belge et regagneront leur emplacement
sur la chaire début 2005.
Une chaire similaire se trouve en l’église de
Nieuport en Belgique.
retour
Le Moulin du
Droogland
Vers les années 1840, un
célibataire, Pierre, François Vanwatermeulen (1791-1857) en est le
meunier.
Le moulin est ensuite cédé à la famille Dequecker
.
Lorsque Louis Dequecker meurt, sa seconde épouse se remarie avec
Henri Debril qui continue l’activité de meunier.
Celui-ci emploie
pendant de longues années un ouvrier meunier, René Nutten, père et
grand-père d’une grande famille résidant encore actuellement dans le
canton de Steenvoorde.
Plus tard Madeleine, la fille de Louis
Dequecker, et son mari Jules Goussen devinrent meuniers.
Jules
Goussen, mutilé de guerre 1914 -1918, dut se séparer du moulin en 1928. Ce
dernier est alors acheté par Monsieur Achille Boudry, descendant d’une
lignée d’anciens meuniers.
A la suite de sérieux ennuis de santé et,
sur les conseils de son médecin, Achille Boudry abandonna le moulin.
Celui-ci fut abattu, avec regret, en 1934 et remplacé à l’époque par
une petite minoterie

retour |
|
Le jeu de
Boule plate
par le Docteur C. DEVRIENDT ( extraits
1939)
Le touriste qui parcourt la
Flandre ne manque jamais de visiter les villes et musées de Bruges, Gand,
Anvers et en Flandre française ceux de Lille, Bailleul et Dunkerque. Il
jette un regard nostalgique aux derniers moulins et s’en retourne avec la
conviction d’avoir tout vu, tout compris. Et pourtant ce dimanche après
midi, pendant qu’il presse sa voiture sur les grands chemins, il est agacé
par des attroupements qui encombrent les bas côtés. Que veulent donc ces
hommes qui gesticulent, courent, s’écartent, hurlent et
s’esclaffent ? Ne pourraient-ils faire place ?

Ce touriste serait
pourtant bien inspiré de s’arrêter et d’observer avec intérêt tous ces
va-et-vient car au bout de quelques minutes et sans l’aide d’un guide
quelconque, l’âme flamande lui serait devenue sensible comme si le pays
lui avait mis dans la main son cœur de chair.
Ces gens qui pullulent
sur les routes comme des mulots dans les champs se livrent en effet à la
passion favorite de tout flamand bien né : au jeu de boule, au
"bolspel" et l’objet en bois qui les attire comme un aimant est la boule
plate, "de plate bol", un joujou sans équivalent dans la France entière et
qui ne semble guère connue des auteurs folkloristes.
La boule plate
n’est pas la "sphère" des Provençaux; elle ressemble à un disque épais, à
un pain rond : une vraie tête de flamand mais mieux équarrie. Elle
est légèrement biseautée de sorte que le tour ou surface de roulement
représente un plan incliné ; cette disposition permet de distinguer
deux faces inégales : l’une le contre-fort ou le "contre-boote"
constitue le versant extérieur dont le diamètre mesure la hauteur maxima
tolérée dans les concours (22 centimètres), l’autre, plus importante,
appelée "de boote" ou "le fort" constitue le versant intérieur. Les
flamands de Belgique la nomment d’une façon plus expressive le "trok" ( de
trekken = tirer) : c’est en effet de ce côté qu’elle penche et
qu’elle tombe. De plus, si au départ la trajectoire de la course est une
ligne droite sous l’action de la vitesse initiale, en fin de parcours,
sous l’effet du "tirant", du "trok", elle décrit une courbe de sorte que
la figure tracée sur le sol ressemble assez bien à une longue crosse
d’évêque ou à un immense point d’interrogation. Le rayon de cet arc
de cercle final peut être modifié par l’adjonction au "boote" d’une coulée
de plomb ou d’une grosse vis comme le font les Flamands de Belgique; les
Flamands de France se contentent d’y coller au moment du jeu une masse
variable de terre glaise appelée "clyte".

La boule plate est un objet
strictement personnel au même titre, dit le Flamand, "que sa pipe et sa
femme". En temps ordinaire, elle est reléguée au fond de la cave où elle
évite de se dessécher ; mais, au moment des concours, elle remonte
dans l’armoire ou sous le lit, à l’abri des maraudeurs de la maison. La
veille d’un tournoi, elle prend un bain pendant toute la nuit afin de
conserver sa pleine densité ; en sa compagnie fait trempette un
morceau de "clyte" qui devient ainsi compacte et malléable. A la mort de
son maître, la boule est donnée à un de ses fils ou au meilleur ami. Elle
porte souvent un prénom féminin et peut être revêtue d’une robe verte,
rouge ou blanche ! être sertie d’un anneau de cuivre ou de plusieurs
rangées de petits clous : plus elle est lourde, mieux elle route… à
condition d’être maniée par un bras vigoureux. Elle est tournée par le
charpentier du village dans les arbres du pays : l’orme, le chêne et
plus rarement le pommier. Ses dimensions varient au goût du client, depuis
la grande boule massive et trapue, lente et majestueuse qui va droit son
chemin, en dépit des cailloux, des ornières et des caniveaux, jusqu’à la
petite boule d’une course moins jolie mais plus pittoresque : elle va
si vite qu’elle semble avoir peur de ne pas arriver et puis elle tombe
brusquement comme une personne hors d’haleine ! Mais l’une et l’autre
a ses avantages et ses inconvénients : la grande boule conservant
longtemps la vitesse acquise, dépasse facilement le but ; de plus son
lancer doit être impeccable : une faute d’inclinaison au départ est
amplifiée sur le trajet et la courbe finale se trouve faussée; la petite
boule est plus approximative mais elle se faufile, s’agrippe, saute,
chavire et se redresse et peut ainsi réaliser des succès de surprise; la
première, objet de précision, est réservée aux maîtres; la seconde aux
gringalets, aux amateurs et aux femmes : c’est une "bonne fille" qui,
par ses cabrioles, fait les frais de verve des "bolders".
Dans les
villages de la plaine chaque estaminet dispose comme terrain de jeu :
d’une route ; d’une place ; d’une pelouse ; ou d’un square
souvent agrémenté de tilleuls, de peupliers ou d’un bosquet d’ormes. La
"compagnie-bolling " ou de l’ensemble de joueurs présents se divise
en deux camps. Les buts -toujours fixes- sont tracés à la craie sur un
galet ; un pavé ; une brique, sous forme d’une petite croix. Le
centre de cette croix s’appelle le "staak" ou le "doel" ou, en Flandre
belge, le "put", il est coiffé d’une touffe d’herbe qui le rend
visible.

L’intervalle entre les
"staaks" varie suivant la disposition des lieux. Habituellement un bolder
fait vingt pas d’un doel à l’autre. L’enjeu est un verre de bière, une
tasse de café, parfois une marmite de vin chaud. On convient d’un total de
points (8,9,10) que devra obtenir un camp pour être déclaré vainqueur. Les
points sont comptés de la manière suivante : tous les bolders d’un
groupe, puis ceux de l’autre placent leur boule ; la plus rapprochée
du "staak" désigne le gagnant et donne priorité à son équipe pour
commencer le tout suivant. Mais cette même équipe mérite encore autant de
points qu’elle possède de boules plus proches du but que la boule la mieux
placée de la compagnie rivale. En cas de contestation, on mesure les
distances à l’aide d’un fétu de paille, d’un mouchoir ou d’une longue
ficelle...
A Winnezeele la pratique de ce jeu est régulière, et vous ne
manquerez pas de voir les habitués s’adonner à leur passe temps favori sur
le terrain communal situé derrière l’école ou sur un bout de route
tranquille !
.
retour |
Le tir à
l’arc
La pratique du tir à l'arc
à la perche verticale reste très vivace à Winnezeele Ce sport est
issu d'une longue tradition que des fervents s'attachent à faire vivre au
sein d’une société.
Le stand de tir à l'arc sur perche verticale ne
passe pas inaperçu dans le paysage communal. Il est intégré dans le
terrain de sports et permet aux amateurs de développer leur adresse dans
un cadre agréable.
Ce tir est une tradition du Nord de la France.
L'Union des associations des archers du Nord de la France compte près de
4000 membres au sein des 73 sociétés de la région Nord-Pas-de-Calais. Ces
dernières portent souvent le nom de Saint-Sébastien, patron des
archers.

Les sociétés de tireurs à
l’arc et à l’arbalète, encore très nombreuses dans le Nord de la France et
en Belgique, ont une origine très ancienne.
Il y avait à Winnezeele une
société d’archers, sous l’invocation de Saint-Sébastien, instituée par les
comtes de Flandre et dotée par D. d’Averoult, seigneur du lieu.
Les
comtes de Flandre et les ducs de Brabant les instituèrent pour la défense
du pays et elles furent appelées « serments » à cause du serment
que chaque membre devait prêter à l’autorité de laquelle il relevait.
Seuls, les hommes de moralité parfaite étaient admis dans la société et
une faute grave entraînait l’exclusion.
Les archers et arbalétriers
jouissaient de divers privilèges, dont l’exemption pour la vie de toutes
failles, guet, gardes.
Ils recevaient de l’échevinage un salaire et on
suppose qu’ils avaient une retraite.
En temps de paix, ils continuaient
à s’exercer en tirant à la perche ou au berceau.
Chaque société
possédait un roi, un connétable, un capitaine et un porte drapeau. La
royauté s’obtenait par adresse et se renouvelait tous les ans (tir du
roi), à moins que le titulaire n’obtienne le titre de nouveau, en abattant
le "papegeay".
Les jeux s’ouvraient le 1er Mai et se terminaient vers
la fin Octobre.
Les premiers coups étaient tirés par des personnes de
marque. Les sociétés organisaient assez souvent des concours et des fêtes
splendides avaient lieu à cette occasion. Ils étaient parfois accompagnés
de ménestrels rétribués par l’échevin.
Aujourd’hui l’organisation des
sociétés actuelles n’est pas très différente et généralement en Mai à lieu
le tir du roi. Un bariquet est servi et le roi y reçoit soit un couvert
d’argent, soit un plat en étain sur lequel sera gravé son nom et la date
du jour où il a acquis son titre.
Ordinairement en septembre, on tire
le prix du roi, c’est à dire que le roi offre des prix d’une valeur égale
au présent qu’il a reçu.
Celui qui est roi trois fois de suite, ce qui
est rare, est proclamé empereur.
|
Le jeu consiste à
abattre des cibles, appelées oiseaux, situées en haut d’une perche
mesurant environ 30 mètres, les premières cibles se trouvant à 28
mètres du sol.
On appelle ces cibles "oiseaux" car elles
sont constituées de plumes multicolores plantées sur un bout de bois
en forme de bouchon. Ces oiseaux sont embrochés sur des grilles
étagées dont le nombre est variable, 7 en moyenne. On trouve ainsi
de bas en haut les petits oiseaux, l’étage inférieur, l’étage
intermédiaire, l’étage supérieur et tout en haut l’oiseau principal
encore appelé "Honneur ou Coq ou Papegeay".
Ce sport se pratique
avec un arc, généralement en fibre de verre ou en carbone,
développant une force de 20kg en moyenne qui lance des flèches de
80cm. Ces dernières peuvent atteindre la hauteur de 50 à 60
mètres. |


|
Dans la religion chrétienne
catholique, 22 saints et saintes sont associés à des emblèmes comprenant
l'arc ou la flèche. Pour trois d'entre eux, cette association rappelle
leur supplice : St Edmond, Ste Ursule et
St Sébastien.
Né probablement à Milan (ou Narbonne selon les
auteurs), Sébastien est martyrisé à Rome, et enseveli dans une catacombe
sur la Via Appia, près de la basilique qui porte son nom.
A partir de
là, la légende exposée dans les Actes de Sébastien (Ve siècle) a
largement brodé. Enrôlé à Rome vers 283, Dioclétien le nomme
commandant de la garde prétorienne, sans savoir que Sébastien est
chrétien.
Il ne cache pas son activité de prosélyte : il est
arrêté et condamné à mourir sous les flèches de deux soldats.

Laissé pour mort il est
recueilli et soigné par Irène, veuve du martyr Castalus.
Guéri, il va
défier l'empereur qui le fait lapider (ou bastonner) à mort.
Sous le
règne de Charles le Chauve (840-877), l'évêque de Soissons fait le vœu de
faire venir des reliques de Saint-Sébastien dans son diocèse. Pour ce
faire, il arme chevaliers les archers de la Compagnie de Soissons et les
charge de cette mission. Cette chevauchée accomplie par des archers à
vocation de fantassins, rapportant des reliques aux abbayes de
Saint-Médard et de Saint-Waast, est à l'origine de la "Chevalerie de
l'Arc".
Saint-Sébastien est bien évidemment le saint patron des
archers. Traditionnellement un tir est organisé autour du 20 janvier par
chaque club ou compagnie.
Toxophile,
Toxophilite : nom masculin, celui qui aime, étudie ou pratique
l'archerie.
Du Grec phile qui aime, qui affectionne,
et toxon qui possède plusieurs sens :

retour |